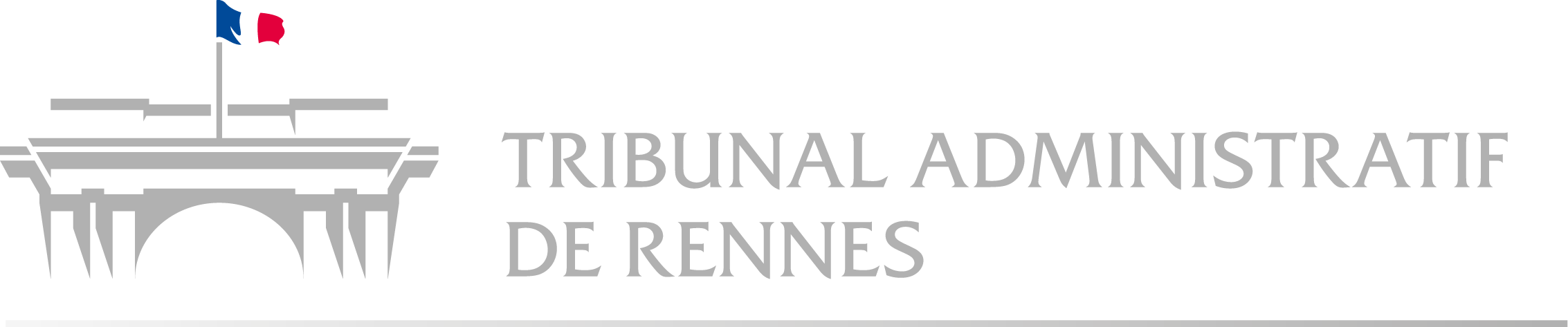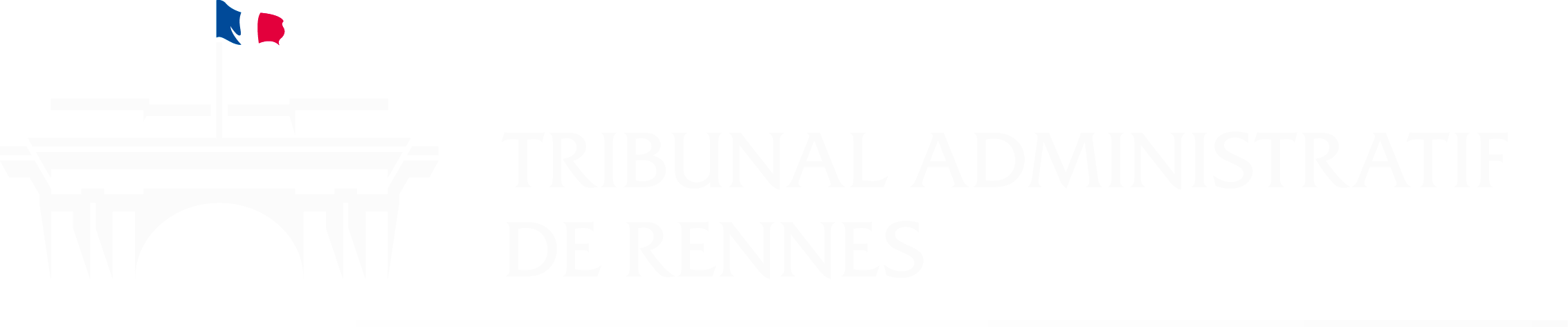Retrouvez les décisions marquantes
Services publics. Services d’incendie et de secours. Frais d’intervention.
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions se rattachant directement à leurs missions de service public telles qu’énumérées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : incendies, autres accidents, sinistres, catastrophes technologiques ou naturels. C’est pourquoi l’article L. 1424-42 du même code leur permet, s’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ces missions, de demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, définie souvent de manière forfaitaire. On pense assez naturellement aux sauvetages d’animaux domestiques qui, bien que contribuant à attendrir le public, n’en sont pas moins souvent fort coûteux.
La jurisprudence a été amenée à donner de ces règles une interprétation fort utile dans le cas de plus en plus fréquent des alertes données par les sociétés privées d’alarme et de téléassistance lorsque le déclenchement de telles alertes, qui débouche sur une intervention d’une équipe d’un SDIS, est dû à une fausse manipulation du dispositif d’alarme par la personne ayant contracté avec la société privée.
Tel était le cas en l’espèce de cette personne âgée qui avait déclenché l’alarme par inadvertance et se trouvant dans son jardin, n’avait pas davantage répondu aux trois appels de levée de doute de la société de surveillance laquelle avait donc transmis l’alerte au centre du SDIS le plus proche. La constatation de la fausse alerte avait conduit le SDIS à réclamer à la société de télésurveillance la somme forfaitaire exigée en pareil cas.
Faisant application d’une solution arrêtée depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2023, le tribunal a constaté que même si, a posteriori, l’intervention s’était révélée inutile, elle n’en avait pas moins été déclenchée dans le cadre de la mission de service public de secours aux personnes au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et relevait donc bien des missions dévolues au SDIS. En outre, dès lors que le dossier ne permettait pas de contester que la société de surveillance avait bien respecté le protocole de vérification des circonstances susceptibles d’avoir déclenché l’alerte, l’intervention qu’elle a finalement sollicitée du SDIS n’a pas été regardée comme ayant été réalisée à son seul profit, ce qui aurait, dans le cas inverse, justifié qu’elle conserve à sa charge le coût de cette dernière.
Le tribunal a donc relevé la société de l’obligation d’assumer ce coût en annulant le titre de recette émis à son encontre.
> Lire le jugement n° 2001257 du 11 janvier 2024
Procédure. Compétence de la juridiction administrative. Indemnisation des fonctionnaires exposés aux poussières d’amiante
Procédure. Compétence de la juridiction administrative. Indemnisation des fonctionnaires exposés aux poussières d’amiante. Action subrogatoire exercée contre l’Etat le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Compétence pour une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Renvoi au Tribunal des conflits.
Le requérant, qui a été employé dans la marine nationale dans des conditions qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, a développé un cancer broncho-pulmonaire primitif, en lien avec cette exposition dont le caractère professionnel a été reconnu en mai 2016. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère lui a alors attribué une rente annuelle et en juin 2016, il a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation qui a été fixée à 51 000 euros.
Par la suite, le FIVA, subrogé dans les droits du requérant, a saisi la CPAM du Finistère d’une action en recherche de la faute inexcusable de son ancien employeur et demandé sans succès au ministre des armées le remboursement des sommes versées au titre des préjudices subis et des conséquences sur sa rente de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il a alors saisi les juridictions de l’ordre judiciaire mais celles-ci se sont déclarées incompétentes pour connaitre de ce litige ce qui a conduit le FIVA à se retourner vers la juridiction administrative afin de faire valoir ses droits au remboursement des sommes versées au titre des préjudices liés à l’exposition aux poussières d’amiante subis par le requérant.
Le tribunal administratif n’a pas eu la même lecture du litige que ses homologues judiciaires. En effet, si un agent public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur des préjudices provoqués par un accident de travail, ça n’est que dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par une disposition spécifique du code de la sécurité sociale
Or, en l’espèce, dès lors que le montant de 51 000 euros versé par le FIVA avait été remboursé par le ministre des armées en cours d’instance, il ne restait plus en litige que la question de l’indemnisation de la majoration de rente au titre de l’incapacité fonctionnelle permanente du requérant, sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur : cette recherche de la « faute inexcusable » de l’employeur en vue de faire reconnaitre la responsabilité de ce dernier pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, réparation des seuls préjudices directs de la victime qui y sont énumérés, est complètement distincte de l’action susceptible d’être engagée devant la juridiction administrative à fin de rechercher la responsabilité d’une personne publique dont la faute aurait également concouru à la réalisation du dommage.
Le tribunal administratif a donc estimé qu’une telle action qui permet, en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, d’indemniser les préjudices de la victime non réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction judiciaire mais, afin de prévenir un conflit négatif entre les deux ordres de juridiction, puisque l’ordre judiciaire avait déjà décliné sa compétence, il a fait application des dispositions du décret du 27 février 2015 et renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits pour qu’il statue sur cette question de compétence, prononçant un sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
> Lire le jugement n° 2205466 du 23 janvier 2024
Collectivités territoriales. Compétences. Participations financières.
Les communes n’ont, en principe, pas le droit de participer au capital de sociétés commerciales ou d’organismes à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général. Mais par dérogation à ce principe, les dispositions de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales autorisent les communes et leurs groupements à entrer dans le capital de sociétés commerciales ayant pour objet social la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire.
Cette faculté ne peut cependant s’exercer que dans le cadre général des compétences que détiennent les communes et leurs groupements en vertu du même code.
En effet, à partir du moment où les différentes communes membres d’une communauté de communes avaient décidé de transférer à cette dernière leurs compétences en matière d’aménagement et d’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables, seule la communauté de communes pouvait décider de prendre une participation au capital d’une société commerciale ayant pour objet cette activité de production d’énergie.
La seule localisation du site de production sur le territoire d’une commune membre ne suffit donc pas à justifier une telle participation et c’est ce qu’a rappelé le tribunal administratif, sur déféré préfectoral, dans le jugement par lequel il a annulé la délibération d’un conseil municipal ayant décidé d’autoriser l’acquisition par la commune d’actions de la société exploitante.
> Lire le jugement n° 2300530 du 25 janvier 2024
Responsabilité de la puissance publique. Nuisances imputables à l’activité militaire.
Si en règle générale, la mise en cause de la responsabilité des personnes publiques à l’égard des particuliers ou des entreprises qui subissent des dommages du fait d’une décision ou d’un agissement de l’administration est subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une illégalité faute commise par cette dernière, il est possible, dans certaines hypothèses, d’obtenir une condamnation de la personne publique à qui l’on impute la réalisation d’un préjudice du seul fait de l’existence d’un ouvrage public, de la réalisation de travaux publics ou de la poursuite d’une activité publique, et ce, sans forcément avoir à démontrer l’existence d’une faute ou d’une illégalité.
Cette responsabilité « sans faute » peut être engagée soit à raison du risque particulier qu’est susceptible de faire peser l’activité ou l’ouvrage public soit à raison de la sujétion particulière qui repose sur le voisinage d’une telle activité ou d’un tel ouvrage, alors que sa poursuite ou son fonctionnement va dans l’intérêt de tous et qu’ainsi, il s’agit de remédier à ce qui apparaît comme une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Encore convient-il que soit apportée une double démonstration : celle d’un lien indiscutable et direct entre l’activité ou l’ouvrage et le préjudice invoqué ; celle d’une particulière anormalité et spécificité (ou spécialité, en termes juridiques) du préjudice invoqué.
L’affaire jugée par le tribunal administratif de Rennes offre, dans un contexte particulièrement original, un exemple de ce mécanisme puisqu’il s’agissait pour un dresseur animalier breton spécialisé dans le dressage des animaux de spectacle, d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité du ministère des armées dans les troubles et pertes constatés dans son cheptel du fait d’exercices militaires parfois particulièrement bruyants, intrusifs et traumatisants (usage d’armes à feu, survols par des hélicoptères, scénarios de combats…) réalisés à proximité de son installation.
Le récit du dresseur, dont il était apparu qu’il ne pouvait ignorer, en s’installant dans ce secteur, qu’il serait exposé à des nuisances, n’était toutefois pas assorti d’éléments suffisamment probants pour démontrer le lien direct entre la fuite, les blessures ou la mort de certains de ses animaux avec les exercices militaires et le tribunal a donc rejeté sa requête indemnitaire.
> Lire le jugement n° 2103295 du 8 février 2024
Libertés publiques. Sécurité civile. Utilisation de drones.
Si la préservation de l’Etat de droit ne signifie pas de priver les autorités en charge du maintien de l’ordre public et de la sécurité des personnes et des biens de toute possibilité de recourir à des outils performants, elle implique que cette dernière soit enserrée dans des limites strictes et contrôlées. C’est précisément ce qu’avait rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 janvier 2022 lorsqu’il avait eu à se prononcer sur l’insertion dans le code de la sécurité intérieure de dispositions autorisant le recours à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs : en d’autres termes, il s’agissait du recours, par les forces de l’ordre, à des drones en particulier dans le cadre de manifestations susceptibles de se tenir sur la voie publique.
Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Dans de tels cas de figure, le Conseil d’Etat a déjà estimé que le respect du droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, ainsi que la liberté d’aller et venir, doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, le recours à de tels outils pour assurer la sécurité d’un rassemblement doit, compte tenu de l’atteinte à la vie privée nécessairement portée par le recours à des drones qui permettent de capter et transmettre des images d’un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements et, le cas échéant, sans qu’elles en soient informées, être justifié et strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
En l’espèce, et en d’autres termes, il ne suffisait pas qu’un ministre, fût-il de l’intérieur, annonce son déplacement dans une ville et que 80 personnes, syndicalistes ou opposants à la loi immigration, aient décidé de se réunir en différents points de la visite prévue afin de l’y « accueillir » , pour que soit ipso facto justifié le recours, pendant une demi-journée complète, à l’utilisation de drones sur un périmètre qui, en l’espèce, couvrait une secteur couvrant une part significative de l’agglomération rennaise. Les explications fournies par le préfet d’Ille-et-Vilaine pour justifier cette utilisation, même peu de temps après les manifestations des agriculteurs et des enseignants, n’ont donc pas convaincu le juge des référés du tribunal administratif qui, saisi par un riverain d’une procédure de référé liberté, a estimé disproportionnée l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale au regard de la réalité des risques, et a décidé de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral.